Mariage religieux et loi québécoise

|
| Image : Inform'elle |
COMMUNIQUÉ - Inform’elle est un organisme à but non lucratif de la Montérégie dont la raison d’être est de rendre accessible et de vulgariser l’information juridique en droit de la famille. Ses services s’adressent à toute la population. L’action sociale d’Inform’elle vise l’autonomie des femmes de même que l’égalité des hommes et des femmes.
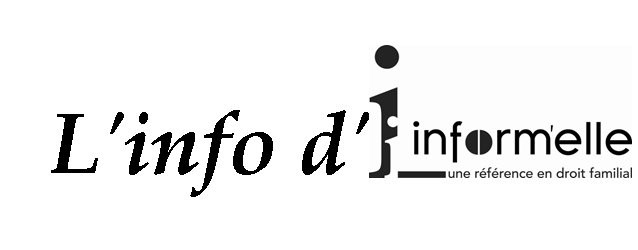
Mariage religieux et loi québécoise
Par Marie De Santis, étudiante en droit, 2020. Révisée 2024 par Claudia Ragi.
Alexandra et Julien sont un jeune couple vivant à Montréal. Après plusieurs années de vie commune, ils ont décidé de se marier. Alexandra souhaite une cérémonie religieuse, tandis que Julien préfère un mariage civil pour simplifier les démarches. Mais comme Alexandra insiste, Julien aimerait comprendre les effets et la validité d’un contrat de mariage religieux.
Au Québec, il est possible de célébrer un mariage civil ou religieux. Pour qu’il soit valide, il faut respecter plusieurs règles. Il doit être fait entre deux personnes âgés d’au moins 16 ans; le consentement doit être libre et éclairé; la personne doit être célibataire ou divorcée d’un précédent mariage, la polygamie étant interdite. De plus, le mariage doit être célébré par un célébrant reconnu par la loi. Le célébrant peut être un greffier, un notaire, un maire, un membre du conseil municipal ou un fonctionnaire municipal pour un mariage civil, ou un ministre du culte pour une cérémonie religieuse. Les ministres du culte peuvent refuser de célébrer un mariage si les conditions religieuses ne sont pas respectées. Un proche peut aussi être autorisé à célébrer un mariage par le Directeur de l’état civil s’il fait la demande et si les conditions sont respectées.
Si deux personnes se marient dans le cadre d’une célébration religieuse, le célébrant est obligé de remettre la déclaration de mariage au Directeur de l’état civil. Cela permet au couple de bénéficier des effets civils du mariage (régime matrimonial, patrimoine familial et obligation alimentaire).
Le couple peut aussi établir un contrat de mariage. Pour qu’un tel contrat soit valide, l’acte doit être fait devant un notaire. Le contrat peut porter sur les donations en faveur de l’autre époux mais aussi sur les dispositions en cas décès. Pour ce qui est du régime matrimonial, il permet au couple de sélectionner de quelle façon les biens seront administrés durant le mariage et en cas de séparation. Il est à noter que le régime matrimonial n’inclut pas les résidences, les meubles et les véhicules de la famille. Toutes les autres conditions et effets du mariage sont d’ordre public, c’est-à-dire qu’on ne peut prendre des dispositions différentes ou contraires dans un contrat.
Ils peuvent aussi établir un contrat de mariage religieux mais celui-ci doit s’exprimer dans les limites formées par les valeurs fondamentales de la société canadienne et reflétées dans les lois québécoises. Par exemple, la clause qui prévoit qu’une dot sera versée à l’épouse en cas de divorce, dans un contrat de mariage, n’est pas valide. En effet, la loi québécoise prévoit plutôt le partage du patrimoine familial et l’octroi potentiel d’une pension alimentaire. Toutefois, si le contrat ne contrevient pas à la loi, ni aux droits et libertés civiles, et que les époux y ont consenti librement, on considère qu’ils sont obligés de respecter leurs engagements et de payer les sommes prévues. Par exemple, si un contrat indique que les époux obtiendront un divorce religieux après leur divorce civil, et que le mari refuse par la suite d’accorder le divorce à sa femme, cette dernière peut obtenir des dommages-intérêts.
Il est donc important pour Julien et Alexandra de comprendre les obligations et les droits de chaque régime avant de faire leur choix.
Notes : L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Chaque situation mérite une analyse spécifique. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire.
Règle d’interprétation : la forme masculine peut inclure le féminin et vice versa.

